Quelques
critiques
:
a)
La première vient du Maître lui-même : Wittgenstein.
Celui-ci a contesté l'idée selon laquelle les "faits" signifient
uniquement "les faits empiriques", vérifiés expérimentalement.
Pour Wittgenstein, un fait peut être une expérience personnelle, une
émotion artistique etc..
Rappel
: Wittgenstein n'a jamais fait partie officiellemennt du Cercle
de Vienne
b)
Une seconde vient d'un de ses disciples : Karl Popper
(photo ci-dessous). Popper refuse
l'inductivisme : ce n'est pas parce qu'il y a de très nombreux faits
en faveur d'une loi qu'elle est universelle et claire.
L'histoire de l'évolution de la vie, par exemple, démontre que celle-ci
défie sans cesse les lois générales de la matière.
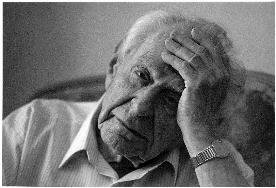 Popper
: "Quel casse tête
!
Popper
: "Quel casse tête
!
Pourquoi me lancer dans des questions pareilles !"
-
Karl
Popper, plus généralement, estime que la validité
d'un énoncé scientifique repose sur le fait
qu'il peut être contredit par un fait. C'est
ce qu'il appelle le principe de "falsifiabilité"
(quel affreux mot !). Popper est un logiciste
: seul un critère logique (sa "falsifiabilité")
peut déterminer si une proposition est scientifique
ou non (et non une accumulation d'expériences)
Pour
Popper, le marxisme et la psychanalyse ne sont pas des sciences :
Pourquoi ? Parce qu'ils prétendent rendre compte..
de tous les faits sociaux et économiques (pour le premier)
et de tous les faits mentaux et psychologiques (pour la seconde)...
Ils ne peuvent donc pas être "réfutés" ("Falsifiés"
selon le mot de Popper)
-
Cela
dit, la position de Popper n'est pas très convaincante non
plus : Toute tentative rationnelle de démarquer "science"
par rapport à "métaphysique" (ou philosophie) oublie
que l'homme (le social, le religieux, l'artiste etc...) est
derrière le savoir.
-
Il
y a toujours des présupposés métaphysiques cachés derrière
les sciences (voir Whitehead,
l'ami de Russell)
-
Il
est impossible aujourd'hui de trouver un fondement ferme
et définitif d'aucune science (voir le texte de Ladrière,
indiqué dans ce site)
-
Carnap,
Popper et compagnie omettent la question de la complexité
du réel et du langage. Je renvoie à Whitehead bien sûr,
mais aussi à Edgar
Morin.
c)
Un troisième lieu de critique est intéressant
: les positions de Lakatos (bientôt en
ligne) et de Feyerabend
: ils préparent le terrain à des visions plus sociales,
plus humaines, mais peut-être aussi moins rationalistes et
plus chaotiques.
Et
là, on saute aussi à
Prigogine, Stengers ou
Morin
et bien d'autres avec eux
 - Mon
opinion perso...
- Mon
opinion perso...

