Caractéristiques
de la pensée des "Viennois"
-
Un
empirisme vigoureux : seuls les faits expérimentés scientifiquement
et formellement exprimés sont porteurs de sens. Cette insistance
sur "l'expérimentation" et sur le formalisme (logique
et mathématiques), contre toute autre forme possible de connaissance,
fait dire d'eux qu'ils sont des positivistes logiques.
La
plupart des membres du Cercle de Vienne sont athées
(ils ne croient pas en Dieu)
ou au moins agnostiques (si Dieu existe, on n'en sait rien
et on ne peut rien en dire).
-
Le
"statisticisme" (mot que je crée pour l'occasion)
: les viennois ne sont pas sots. Ils savent bien que la somme
des énoncés d'expérimentations ne fait pas une théorie -problème
de l'induction- (voir Hume).
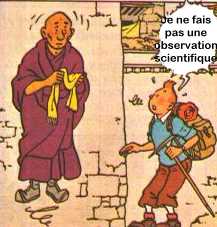
-
Pour
qu'une théorie soit valable, il faut qu'elle s'appuie sur un très
grand nombre d'expérimentations ! Mathématiquement, les lois des
grands nombres se traitent par les statistiques qui indiquent
les tendances des faits. Les sciences de l'avenir sont donc les
statistiques.
Ainsi,
la loi de la gravitation
universelle est valable
parce qu'elle est vérifiée par toutes les expériences...
L'observation par Tintin du moine tibétain qui fait de la lévitation
ne peut pas faire l'objet d'un énoncé scientifique...
Image
scannérisée dans "Tintin au Tibet"
Editions Castermann.
On
dira des acteurs du Cercle de Vienne que ce sont des "inductivistes",
c'est-à-dire des penseurs qui estiment que la logique de l'induction
est tout-à-fait défendable.
Cette
représentation des sciences fait beaucoup de bruit.
Elle a l'avantage d'avoir avec elle
le soutien de l'évolution des sciences elles-mêmes,
notamment : la physique
quantique.
Le
Cercle de Vienne se dispersera après l'arrivée au pouvoir des nazis
et plusieurs de ses membres continueront leur carrière aux États-Unis.
Mais il aura une grande influence sur la
philosophie, sur les sciences du langage et sur la sémiologie au
XXème siècle, notamment aux États-Unis.
 - Critiques
- Critiques


