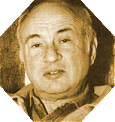Ici,
Morin fait un procès des pratiques dérivées de
l'asservissement dont il a développé de longues pages
«C'est
au XIXème siècle que se multiplient des "crises
de biocénose" issues d'interventions humaines visatn un
objectif "précis", c'est-à-dire conçu
isolément, sans conscience des interactions éco-organisatrices
auxquelles participe le phénomène qu'on veut éliminer,
sans non plus concevoir les perturbations éco-organisationnelles
qu'entraînera le phénomène qu'on verra apparaître.
Ainse l'élimination d'une espèce (rongeur, insecte,
parasite) jugée nuisible à une culture donnée
entraîne la prolifération dévastatrice d'une autre
espèce nuisible...
Il
y a aussi, dès le XIXème siècle, les appauvrissements
écologiques quasi irrémédiables provoqués
par des déboisements massifs : les sols fertiles sont entraînés
par les eaux de ruissellement, lesquelles, moins bien retenues que
dans les forêts, provoquent des inondations...
Plus
généralement, toute monoculture détruit les association
végétales, profitables à chacun et à tous,
réduit la faune, appauvrit et stérilise la terre. Dès
lors, le processus de dégradation de la complexité est
en marche partout où progresse l'homogénéisation
monoculturale...»
[Edgar
Morin : La vie de la vie, p.70-74]
C'est
bien sûr toujours au nom du même constat d'oubli de la
complexité
que Morin dénonce ces pratiques.
Il développe ces points dans de longues pages
Morin
montrera ensuite que l'asservissement de la nature devient un
asservissement de l'homme lui-même

Retour
textes de Morin